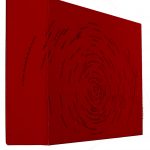« Le tatoueur doit être vulgaire, son aspect louche et sa physionomie inquiétante ».
Voilà un cliché qui a la peau dure. Et c’est Bruno, le maître tatoueur le plus reconnu de France, qui s’en amuse dans son livre Tatoues, qui êtes-vous ? Pour pénétrer dans le studio de la tatoueuse barcelonaise Joana Catot, il faut se rendre à Gracia, quartier nord de Barcelone en pleine gentrification. Au lieu de descendre dans un studio mal aéré et sans hygiène, on monte les escaliers d’un immeuble un brin bourgeois. Une femme aux traits radieux et au sourire grand comme une banane ouvre la porte. En refermant, on laisse derrière-nous toutes nos idées reçus sur l’identité du tatoueur. Elles n’ont pas cours ici.
L’art de dessiner sur la peau
Pour la quarantenaire catalane, le tatouage n’a rien d’une évidence. Au début. Car c’est plutôt le chemin de la couture qu’elle prenait quand, à 26 ans, elle avait déjà deux gosses et un avenir tout tracé dans un petit village de l’arrière-pays catalan. Mais à force de la voir dessiner, une amie lui conseille de s’inscrire à des cours. Elle a 26 ans. Ecole des arts appliqués de Vic, puis école de design et art Eina de Barcelone. Joana devient designer graphique, s’éclate dans une profession qui lui permet de bien gagner sa vie tout en conservant une touche artistique. « Au final, j’ai étudié 10 ans et j’ai acquis une solide formation en arts plastiques et en design », résume-t-elle.
Apprentie artiste, elle a dessiné et peint sur de nombreux supports, mais jamais sur un support vivant et mouvant. « Un jour j’ai vu un tatoueur dessiner sur la peau de quelqu’un. Ce n’est pas immédiatement le travail qui m’a intéressé mais plutôt l’idée de peindre non pas une toile, mais la peau, qui est mouvante, qui vieillit, qui ne peut ni s’acheter ni se vendre, qui ne peut pas s’exposer dans un musée… ça m’a paru fascinant ! C’est là que je me suis dit que je voulais sentir ce qu’il se passe quand on peint un corps humain, qu’on ne peut pas l’effacer et qui se marque dans la douleur. »
« Le tatouage est un art parce qu’il crée »
Cette artiste de formation voit-elle le tatouage comme une forme de création artistique ? « Qu’est-ce que l’art ? Je l’ignore. Mais l’autre jour dans le métro j’ai vu une personne avec un tatouage très vieux et très moche. Ça m’a révulsée ou … intéressée. Je pensais que l’art est beaucoup plus dans ce qui me touche et m’émeut que dans ce que je trouve joli. » Pour l’artiste tatoueur Mariano Castiglioni, « Il est difficile d’expliquer ce qui est art et ce qui ne l’est pas, mais le tatouage est un art parce qu’il crée. Souvent, c’est une idée partagée avec le tatoué qui se créée. » Reste que pour Joana, seuls certaines perles parviennent à atteindre un niveau artistique : « Je suis une très bonne tatoueuse, une très bonne designer graphique, mais je ne suis pas une artiste. Par contre, il y a des tatoueurs avant-gardistes en Europe centrale qui sont bien en avance sur mon travail. Ils font des choses hallucinantes ! »
Autodidacte dans un univers sous testostérone
Si Joana Catot accueille aujourd’hui ses client(e)s dans un studio débordant de livres spécialisés récoltés au cours de ses pérégrinations, c’est après avoir cherché par tous les moyens à apprendre cette technique pour laquelle à l’époque, il n’existait ni diplôme ni formation reconnue (aujourd’hui, le gouvernement catalan oblige les tatoueurs à suivre un cours d’hygiène sanitaire et il existe également un diplôme depuis septembre à Barcelone). « Ça a été très difficile de trouver quelqu’un qui veuille bien m’enseigner à tatouer, parce que c’est un monde très fermé. J’ai finalement trouvé quelqu’un qui a bien voulu me l’enseigner, mal, mais c’est à partir de là que j’ai commencé à tatouer dans mon village. Ma chance, c’est qu’à l’époque les tatouages étaient petits, et comme je ne savais pas bien tatouer, ça me convenait. A mesure que les tatouages ont pris de l’ampleur, moi aussi j’ai pris de l’expérience. »
« Barcelone, une oasis de studios de tatoueurs et de tatoués en tout genre. Inutile d’essayer d’y marcher dix minutes sans croiser une épaule ou un avant-bras tatoué. »
Puis la rupture personnelle vient tout accélérer : « Je tatouais de plus en plus dans mon village. Puis j’ai divorcé et je suis venu m’installer à Barcelone. Là, le tatouage est devenu omniprésent pour moi. » Barcelone, une oasis de studios de tatoueurs et de tatoués en tout genre. Inutile d’essayer d’y marcher dix minutes sans croiser une épaule ou un avant-bras tatoué. Joana travaille dur dans un atelier très populaire dans le quartier du Raval. Après cette expérience, elle est mûre pour s’y dédier à 100%.
Anthropologie itinérante du tatouage
Mais quelque chose manque. Tout cela est trop mécanique, pas assez créatif. « Probablement du fait de mon héritage des Beaux-Arts et de l’histoire de l’art, j’ai commencé à me demander ce qu’était vraiment le tatouage. D’où vient-il, que sent-on, ce qu’en pensent les gens. » Le hic, c’est que, bien qu’elle adorerait rencontrer des gens pour en débattre, « dans ce pays il n’y en a pas. »
Internet devient alors une véritable mine d’or pour assouvir son besoin d’en savoir plus sur les différents visages de cette pratique vieille comme le monde. Peu à peu, la source se tarie face à la soif de savoir de la tatoueuse : « Sur Internet, je trouvais beaucoup de récits, mais il y a beaucoup de copier-coller, tu te rends compte que sur les 100 articles qui parlent d’un lieu, une seule personne s’y est vraiment rendue. »
« Tous les peuples du monde sont tatoués »
Reste une solution, celle d’un nouveau départ : « J’étais très intéressée par Hainan, une île au sud de la Chine. Sur Internet, certains disaient que oui, d’autres que c’était fini, et d’autres encore qu’à Hainan, seules les femmes continuaient à se tatouer. Eh bien j’y suis allée ! L’expérience a été tellement bonne que j’ai décidé de voyager dans toutes les parties du monde pour voir si on se tatouait, comment, si la pratique disparaissait ou au contraire y retrouvait une nouvelle jeunesse ».
Comme elle, le tatouage semble ne jamais s’avouer vaincu. Entré dans le dictionnaire français à la moitié du XVIIIème siècle avec les récits de voyageurs dans les îles du Pacifique ou en Afrique, il est aussi vieux que le monde et plus diffus que le football : « Ce qui me paraît fascinant, c’est que tous les peuples du monde sont tatoués, des Inuits aux Africains, dont les scarifications sont pour nous des tatouages, aux Indiens d’Amérique, en passant par les Russes … tout le monde ! » Myanmar, Bénin, Californie, Hainan, Algérie, ses destinations sont aussi éculées que diverses, mais ont toutes pour point commun la quête d’autres pratiques de tatouage. « Je voyage à travers la peau des autres », sourit-elle.

Au retour, les anecdotes et les découvertes sont si nombreuses qu’elle se met à les partager au cours de conférences, de la Catalogne à l’Argentine. « Ma dernière destination a été le Cameroun, où je suis me suis rendue avec l’anthropologue Joan Riera. Nous avons été à la rencontre d’un peuple pygmée, les Baka, et nous avons eu la chance d’assister à une cérémonie d’initiation où on affinait les dents de jeunes adolescents. Nous avons aussi observé une séquence de scarification de jeunes filles. Mais c’était de petits tatouages. »
Les femmes, dernières gardiennes du tatouage
Pourquoi Joana a-t-elle emprunté les routes si peu courues qui mènent aux différentes cultures du tatouage du monde entier ? Difficile à dire, tant tout pour elle est accompagné des superlatifs « brutal » ou « fascinant ». Mais un détail retient l’attention. Seule femme tatoueuse de son âge en Espagne, autrement dit pionnière de la féminisation de cette pratique en Europe, elle découvre une réalité inverse au cours de ses voyages : dans des cultures où le tatouage est en perte de vitesse, ce sont les femmes qui continuent de le porter. « Les hommes sont les premiers à avoir des contacts avec le monde moderne. Les habitants de l’île de Hainan doivent aller vendre sur les marchés et leurs peintures corporelles sont la risée des Chinois. Les Machis de l’Amazonie au Brésil retirent leurs piercings quand ils vont travailler en ville. Pendant ce temps, les femmes restent dans la communauté. A Hainan, il ne reste presque plus de tatouées. » De quoi rasséréner, et lui donner envie de devenir la voix de ces femmes et leurs pratiques culturelles qui tombent en désuétude.
Le tatouage n’est pas une mode, mais il est à la mode
Rien à voir avec les pays occidentaux où ce que l’on considérait encore comme un passe-temps de taulard au temps de Bruno devient une preuve de goût chez les nouvelles générations. « Le tatouage est à la mode mais ce n’est pas une mode », nuance Joana, satisfaite : « C’est bien que le tatouage ne soit pas qu’une curiosité car c’est beaucoup plus profond que ça : c’est autant une manière d’être, d’expliquer, de revendiquer quelque chose que tu as besoin de démontrer, de montrer, de souffrir… Sans ce mouvement, beaucoup de travaux ne seraient pas acceptés et nous n’aurions pas non plus un matériel de cette qualité. »
Pour le psychologue et psychanalyste Serge Tisseron, « le tatouage a toujours été utilisé. La différence aujourd’hui, c’est qu’il se montre. Nous visons une période où les gens cherchent à affirmer leur originalité. » Un autre aspect positif tient à cœur à Joana. La mode en Occident semble avoir ravivé la flamme de certaines communautés qui avaient abandonné le tatouage : « Les Indiens Yurok de Californie que j’ai rencontré il y a quatre ans ne se tatouaient plus depuis 50 ans et, soudain, un groupe de 12 femmes a recommencé. »
Emmanuel Haddad
Le site de Joana Catot :
http://joanacatot.com/