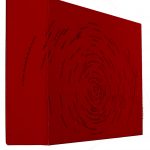Bamako, Mali
¿Has oído que no recomiendan salir a la calle? ¿Dónde estáis? Me llegaba este sms mientras estábamos reunidos con la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en la sede de UNICEF desarrollando un proyecto para prevenir el trabajo infantil en el sector minero en Mali. Al poco rato entraba en la sala el Director de UNICEF. Su rostro me dio a entender que el sms iba en serio. “¿Todo bien?” – “No, no todo bien” me dijo saliendo con los responsables de la organización.

« Estaban confiscando coches. »
Al poco rato nos contaban que no podíamos salir del recinto hasta nueva orden. Al parecer había habido una revuelta militar en Kati, población a 18 kilómetros de Bamako, y era impredecible lo que podría ocurrir. El personal del recinto subía y bajaba las escaleras con nerviosismo. “Todos a vuestras casas, encerraros y no salgáis hasta que os avisemos”. Los militares se habían rebelado ante el ministro de defensa, que había acudido para calmar el malestar que arrastraban hace semanas por las malas condiciones con las que tenían que luchar en la guerra del norte. Llevábamos días siguiendo las protestas de las mujeres e hijos de los militares, y era de esperar que tarde o temprano ellos también saldrían a la calle. Pero al parecer esta vez iba más en serio. Se habían apoderado del arsenal de armas y estaban confiscando coches. Decían que venían a Bamako e iban a por el Palacio Presidencial en Koulouba.
La guerra en Libia desestabiliza la zona
Malí ha sido un país sorprendentemente estable a nivel democrático e institucional, a pesar de ser el 175 de los 187 países en índice de desarrollo humano, tener una esperanza de vida de sólo 49,2 años, y con el 44% de la población viviendo sin acceso a agua potable y el 51% en condiciones de pobreza extrema.
Sin embargo, este último año su estabilidad se ha visto amenazada. La sequía ha generado un estado de emergencia por crisis alimentaria y la guerra en Libia ha ocasionado el retorno de milicianos con armamento sofisticado que ha acelerado la guerra en el norte y puesto en desventaja al ejercito nacional.
A pesar de ello, nadie esperaba un golpe de estado el 21 de marzo. Dentro de un mes se celebraban elecciones y el presidente había afirmado que no se iba a presentar. Todo indicaba a que se iban a realizar de manera estable y ordenada.

« La incertidumbre se adueñó del ambiente y las palabras empezaron a evolucionar: de manifestación a revuelta, a motín, finalmente a golpe de estado ».
Desde el balcón donde estábamos alojados se divisaba la majestuosidad del río Níger, con el característico baile de colores azulados y anaranjados que adquiere cuando se pone el sol. Entonces empezaron los disparos. Y ya no pararon hasta el amanecer. Se oían cañonazos, ráfagas de metralleta, detonaciones. Se veía cómo estaban atacando el palacio presidencial así como la zona ministerial, entregada por Gadafi como gesto de hermandad y relación privilegiada que siempre mantuvo con el pueblo de Mali. La incertidumbre se adueñó del ambiente y las palabras empezaron a evolucionar: de manifestación a revuelta, a motín, finalmente a golpe de estado.

Llegaban noticias confusas, al principio inauditas pero con el tiempo se fueron confirmando. Los rebeldes han ocupado la televisión pública ORTM y la radio; los rebeldes han entrado en el palacio presidencial; los rebeldes han capturado a varios ministros; los rebeldes tienen el control completo de la ciudad.
Durante los siguientes días se fue instaurando un toque de queda respetado sobretodo por la comunidad internacional. El estado anárquico y el vandalismo característico en estas situaciones duró apenas dos días. Acostumbrados a cortes eléctricos constantes, sorprendía la regularidad de acceso a electricidad que se ha tenido desde el golpe. Con ella venía internet, que milagrosamente funcionaba también sin interrupciones, y a través de internet el flujo de noticias vía Twitter y blogs sociales, documentando casi al momento los acontecimientos.
El viernes, día de mezquita para este país mayoritariamente musulmán de 15 millones de personas, reinó un silencio sepulcral que invitó a la reflexión y a todo tipo de conjeturas.
¿Ha sido un golpe inesperado fruto de la cólera militar que se ha ido incendiando a medida que se acercaban al palacio presidencial? ¿O hay intereses detrás del golpe que están instrumentalizando las protestas para boicotear las elecciones? ¿Hay alguna fuerza internacional detrás debido a la falta de determinación que había mostrado el presidente ATT en la lucha contra AQMI en el norte? ¿Y donde está el presidente? ¿En manos de una embajada internacional? ¿Escondido en un campamento militar preparando la contraofensiva? ¿O en manos de los rebeldes en el cuartel de Kati tal como apuntaban algunos?

Durante el fin de semana la tranquilidad se prolongó de manera irritante. Se rumoreaba sobre una contraofensiva por parte de los partidarios del presidente, pero la ciudad callaba y se intuían negociaciones entre ambas partes. Al fin y al cabo, solo había hablado un Capitán (Amadou Sanogo) pero los coroneles y generales de alto rango todavía no se han pronunciado.
Por otro lado, la comunidad internacional ha denunciado el golpe de estado, así como los 10 partidos principales que se presentaban a las elecciones; prácticamente todas las agencias han cancelado las ayudas de cooperación; y las acciones de las empresas mineras, de las que el gobierno es 20% accionista, se han desplomado en la bolsa. Así que si el golpe ha sido un éxito militar, está siendo en fracaso económico en todos los frentes. Un fracaso inmerecido para este país que ya luchaba por superar las adversidades de pobreza extrema y crisis alimentaria este año, y que lo último que necesitaba es un golpe de estado que sólo limita las oportunidades para el desarrollo que su pueblo merece.
Dr. Fernando Casado Cañeque. Director del Centro de Alianzas para el Desarrollo (www.globalcad.org)
Nota: Fernando Casado está informando a diario sobre los eventos de la situación en Malí a través de su cuenta de Twitter: @Fernando_Casado
Para profundizar en el tema, Rezolemag les recomienda este link:
http://panel.vudeo.org/